 Résumé analytique
Résumé analytique
Lun 27 Mar - 8:46
Cours Pascal, Les pensées, liasses II à VIII
Edition Michel le Guern
Vie de Pascal par Madame Périer, sa sœur
Naissance à Clermont le 19 juin 1623 d’Etienne Pascal, président à la Cour des aides et d’Antoinette Bergon.
Sa mère meurt en 1626. Pascal reçoit l’éducation directe de son père.
En 1632, installation à Paris.
Son père, refusant de lui enseigner les mathématiques avant qu’il ne connaisse le latin et le grec, Pascal découvre seul jusqu’à la 32ème proposition d’Euclide. Il rédige à 16 ans un Traité des coniques qui lui offre la reconnaissance des savants de son temps (Descartes, Gassendi, Fermat). Il invente à 19 ans sa machine d’arithmétique qu’il réalise en deux ans. Ses efforts continus entraînent une dégradation de sa santé.
A 23 ans, il réalise l’expérience du vide d’après Torricelli mais à 24 ans la découverte de Jésus-Christ le détourne de ces occupations savantes. C’est alors que sa sœur devient religieuse à Port-Royal des Champs. La santé de Pascal se dégradant, les médecins l’obligent à renoncer aux activités intellectuelles. C’est alors qu’il rentre dans le monde. Sur les conseils de sa sœur, Pascal renonce au monde âgé de 30 ans. Il se livre alors à une existence austère et dépouillée. Il vit ainsi cinq ans. Durant les quatre dernières années de sa vie, la maladie ne lui permet pas de travailler à son œuvre. Il meurt le 19 août 1662 à 39 ans.
Son œuvre apologétique est marquée par l’opposition aux jésuites qui substituaient la grâce suffisante (Dieu sauve ceux qui méritent de l’être) à la grâce efficace (l’homme est choisi et sauvé par Dieu sans pouvoir rien y faire).
II. Vanité
La liasse « Vanité » permet de découvrir une forme d’anthropologie pessimiste où paraissent les caractères principaux de la nature humaine (22):
- Inconstance : qui tire son origine du péché et implique que l’homme n’ait pas d’assise stable
- Ennui dont découle la vanité
- Inquiétude qui pousse au divertissement et aux satisfactions imaginaires
Ces différents caractères ont pour point commun la faiblesse d’une nature dont le péché originel fournit la clé de compréhension. Cette condition n’est pas le fruit du hasard mais tire son origine de la Chute d’Adam, de la volonté de l’homme de s’écarter du bien véritable, bien qu’il lui est impossible de recouvrir par ses propres forces sans le secours de la Grâce (12).
Parce qu’il a perdu sa véritable nature, juste, bonne et droite, l’homme erre entre deux infinis (38) entre lesquels il ne sait pas trouver de critères certains de la justice et du vrai (18-19-35-47). La conséquence de cette situation est la déraison du monde qui conduit les hommes à négliger la vie et le bien pour de fausses apparences (13-16-27-30). A défaut, d’un sens inné du juste et du bien et en raison de son aveuglement naturel, l’homme s’attache aux principes de l’amour-propre que sa vaine imagination et l’estime d’autrui lui représentent comme le bien absolu au détriment de la raison et du bien véritable (28-29-34). Finalement, le désordre et l’arbitraire mènent le monde (32). Tout le problème de cette réalité humaine inconstante est de ne pas pouvoir trouver d’assise sûre, sur laquelle appuyer son jugement. « Le monde est un branloir pérenne » disait Montaigne (Essais, III, 2), formule que Pascal reprend à son compte : « Tout branle avec le temps ».
Pour cette raison, l’homme fonde sa justice sur l’imagination (23-41). Ne pouvant donner un fondement certain et absolument juste aux principes qui régissent la vie sociale, l’homme s’en tient à des signes extérieurs qui valent comme l’indice d’une force inclinant au respect (17-26). Au final, la coutume finit par faire paraître juste ce qui n’est que l’effet d’une habitude (24). Aussi ne faut-il pas s’étonner de la relativité des critères du juste et de l’injuste, du légitime ou du vrai (18-46).
La conséquence de cette situation devrait conduire l’homme à désespérer. Mais pour ne justement pas apercevoir ce qu’il en est de sa nature déchue, l’homme se confie au divertissement comme un moyen d’échapper à l’insupportable vérité de son être (36-37). Les plus illustres d’entre les hommes n’en sont pas exempts (45). De là, l’homme s’ignore lui-même et se confie à l’imagination qui l’empêche de voir ce qu’il en est véritablement de lui-même (43). Cette agitation perpétuelle, ce renversement permanent d’une chose en son contraire (25) peut se nommer inquiétude, impossibilité pour l’homme de considérer son existence, considération qui le conduirait à désespérer de lui-même (ce que Pascal nommera l’ennui (33)) s’il ne s’attachait à de vains biens pour se distraire de cette sienne condition. Cette inquiétude, cette agitation frénétique, fait de l’histoire une suite de hasards et de déraison (42).
L’homme sage devrait reconnaître la vanité de l’homme et se tourner vers le désir du bien véritable (21). Au fond du désespoir entraîné par la considération de la vanité humaine, se trouve l’aspiration à la consolation. Pascal ne récuse pas tant l’existence d’un bien véritable que la possibilité pour l’homme de l’atteindre (19). Le doute qui saisit celui qui considère la réalité humaine et son inconstance est un moyen pour lui de s’apercevoir du manque qui affecte cette nature et du bien auquel l’homme devrait tendre, raison pour laquelle le sage se nourrit en quelques sortes de la folie des autres hommes (31). Reste alors pour tâche au sage de révéler son inconstance et sa déraison au monde, humilier la raison qui se croit triomphante (48) et que le bourdonnement d’une mouche suffit à détourner de son ouvrage en apparence si éclairé (44).
Cette nature humaine se résume donc toute entière sous les termes de vanité et d’imagination, vanité d’un jugement qui prétend tout jauger à l’aune de sa raison (11), mais dont une mouche suffit à révéler la fragilité (20).
Commentaire §41 :
III. Misère
IV. Ennui
La troisième et quatrième liasse « Misère » et « Ennui » poursuivent la description anthropologique entamée dans le livre précédent mais en nous permettant d’insister davantage encore sur les conséquences de la situation de l’homme à la suite du péché originel. Les maîtres mots sont ici inconstance, contradiction et impuissance de l’homme à trouver un critère vrai de la justice. Ces éléments déjà présents dans le livre précédent sont davantage appréciés dans leur rapport à la conscience que l’homme a de sa situation, conscience qui lui masque à lui-même la misère en laquelle le laisse demeurer la perte du bien véritable.
Toute la difficulté d’établir une véritable anthropologie de l’homme déchu consiste dans la contrariété qui affecte ce dernier et qui empêche d’en donner une description simple et univoque (51). On ne trouve pas d’accord de la nature humaine mais au contraire un désaccord permanent de cet être avec lui-même. Tout chez l’homme n’est que tendance vers (existence= ex-sistere), tendance vers un bien qu’il ignore, tendance vers une déchéance qu’il ne connaît pas comme telle. Le but de Pascal n’est dès lors pas la connaissance désintéressée de cet être, mais la prise de conscience des contradictions qui l’assaillent et qui donnent à connaître sa situation malheureuse. Cette anthropologie n’est donc pas séparable d’une évaluation morale qui constitue au final le seul intérêt véritable de cette connaissance de l’homme qui est tout aussi bien une connaissance de soi (68). Se connaître, c’est connaître notre misère et appeler à en être affranchi (65).
Mais qu’est-ce qui nous permet de tenir ce jugement négatif ? Quelle preuve a-t-on de ce malheur qui selon Pascal affecte la condition humaine ?
Un indice nous en est fourni par cette tendance inhérente à l’homme de s’oublier. Etymologiquement, divertir signifie détourner, comme détourner une somme d’argent. Se divertissant, l’homme se détourne de la considération de sa nature essentielle, ou plutôt se divertit pour n’avoir pas à reconnaître cette nature (66) et, se faisant enfreint, la justice, la justice de l’ordre universelle auquel son Créateur l’a voué dans l’état paradisiaque.
Ce divertissement marque la vanité de l’homme que la Bible, dans le livre de l’Ecclésiaste, répète inlassablement, « vanité des vanités, tout est vanité ». Là aussi l’étymologie nous renseigne : vanitas signifie le vide. L’homme est vide, c’est-à-dire radicalement et essentiellement marqué par le manque et par l’absence, absence du bien auquel sa nature première le destinait. Or cette absence crée en même temps la souffrance et le désir de combler ce vide, c’est-à-dire entretient le désir d’un bien, mais d’un bien qu’il ne peut plus se donner et auquel il substitue n’importe quel objet qui ne fera toujours qu’exhiber un peu plus l’impossibilité de combler ce vide. D’où une course effrénée de désir en désir qui, loin de lui permettre de combler ce manque, le détourne au moins de sa considération.
Dans l’état originel, l’homme voulait ce qu’il pouvait, son désir et sa puissance était en accord car conforme à l’ordre naturel prescrit par Dieu. Après la chute, l’homme n’est plus en mesure de pouvoir atteindre le bonheur dont il garde pourtant au fond de lui le souvenir. Sa volonté devenue impuissante car incapable du bien véritable ne lui permettra que de désirer le bien sans jamais pouvoir l’atteindre par lui-même (71). Ainsi l’homme est malheureux, tendant vers un bonheur duquel il ne peut se détourner mais qu’il ne peut se donner.
Mais ce dont l’homme souffre primitivement c’est de l’ignorance quant à sa véritable situation. Il sent qu’aucun bien ne le satisfait vraiment mais il ne peut s’empêcher d’imaginer que cette insatisfaction est causée par l’objet et non par sa volonté elle-même (69). La conséquence est alors l’incapacité de s’en tenir à une direction unique et à toujours entreprendre de chercher ailleurs le plaisir que l’objet présent ne peut donner. Ce qu’ignore alors l’homme c’est que le plaisir qu’il recherche se révèlera toujours aussi vide (vain) et entretiendra perpétuellement sa frustration et la contradiction entre les désirs qu’il cherche à assumer (56). De là résulte, l’inconstance, c’est-à-dire l’incapacité à tenir une voie droite.
Le seul guide que l’homme sait se donner est celui de l’amour-propre qui, au moment même, où se découvre la misère de sa situation le pousse à se flatter de sa sagesse (67) plutôt qu’à en tirer la conséquence nécessaire. Sans cette assise que constitue l’amour de lui-même, la croyance d’être tout, l’homme succomberait à l’angoisse infinie devant son propre néant (64), ce que Pascal nomme l’ennui. La prise de conscience de sa finitude conduit au vertige devant l’infini qui l’entoure. Perdu que nous sommes et rivés à notre amour-propre nous nous satisfaisons de ce que nous imaginons être une réalité. Dans le plus divers, l’imagination nous attache à une unité qui nous paraît constituer une base ferme bien qu’elle ne dissimule qu’une abstraction illusoire (61).
Résumons donc : l’homme est contradiction et inconstance, désir de l’infini et aspiration au néant. C’est toujours tendu entre deux opposés qu’évolue l’homme. Nous nous attachons à un bien qui provoque notre malheur (52), nous rions et pleurons tout ensemble et sur le même objet (50). Nous finissons même par ne plus reconnaître notre dignité propre, l’image que Dieu a empreinte en nous (49) et nous adorons des animaux comme dieux.
L’homme s’imagine maître de lui-même, indépendant, mais cette illusion lui masque sa condition véritable, la dépendance à l’égard d’une réalité étrangère et les besoins auxquels l’astreignent sa nature déchu (73). Reconnaître les nécessités, et donc les limitations auxquelles l’attachent son existence, lui permettrait déjà de se délivrer de l’illusion qu’il entretient à son égard (53). Malheureusement, c’est dès l’enfance que l’éducation conduit l’homme à s’attacher à une fausse idée de lui-même et à se complaire dans un amour-propre qui lui fait se croire tout lors qu’il n’est rien (59), mais un rien qui, s’il est pris en vue pour lui-même, ôte en même temps le désir d’agir.
Bref, nous agissons sans savoir et pour d’autres raisons que celles que nous croyons poursuivre, ces raisons se résumant dans l’amour-propre. En même temps, cet aiguillon illusoire est la condition de l’existence humaine qui pousse, dans l’agitation perpétuelle, à pousser toujours plus loin notre regard pour satisfaire notre orgueil (72) et échapper à l’ennui auquel nous voue la considération de la nullité du bien auquel nous nous attachons comme à une fin dernière (74).
Et pourtant c’est sur la base de cette confusion, sur le rien de son propre néant, que l’homme parvient à édifier un monde social dont l’unique fondement est l’imagination (60). La définition du mien et du tien, la justice qui découle de l’ignorance que l’homme entretient à l’égard de lui-même est double : d’une part, elle n’est pas la vraie justice, d’autre part, cette justice illusoire pallie à ses propres insuffisances, du fait de l’illusion que l’homme entretient à son propos, la croyant juste et bonne en soi. De l’illusion et de l’ignorance même de l’homme peuvent se tirer des fruits illusoires mais suffisants pour lui permettre d’entretenir et poursuivre sa vie.
Il y a un secret qui préside à l’instauration d’une justice commune qui suffit à l’homme alors même qu’elle n’est pas la vraie justice : c’est l’habitude de la regarder comme étant juste. C’est cette habitude que Pascal nomme coutume et qui, selon lui, fonde la possibilité d’un accord minimal permettant à chacun de poursuivre son désir vain sans dommage pour les autres (70). L’existence déchue de l’homme sécrète les solutions aux contradictions qu’elle tisse elle-même, ce qui en même temps redouble l’aveuglement de l’homme sur sa situation, situation qu’il pense fondée en raison (56). La justice à laquelle l’homme s’attache n’est que celle des mœurs auxquelles la coutume et l’habitude le rattachent depuis son enfance. Mais cette justice qui lui paraît naturelle est toute entière artificielle. La justice véritable, naturelle, est celle de l’ordre premier auquel Dieu confia Adam mais que ce dernier perdit du fait de sa volonté rebelle et qu’il nous est impossible dès lors d’atteindre sur la base de notre volonté corrompue, limitée et défaillante.
Aussi ne faut-il pas s’étonner que les principes d’une justice relative passent pour absolus aux yeux de ceux qui sont habitués à s’y conformer, ni non plus qu’une autre habitude, que d’autres mœurs engendre une conception toute différente de la justice (57). L’impossibilité de donner une définition définitive et absolue de la justice humaine expose l’homme aux hasards de la fortune (58) et d’un changement perpétuel des règles qui président à la vie en société (56). Finalement, cette justice humaine est tout sauf juste et repose sur l’arbitraire d’une volonté s’établissant en autorité régnante (55).
Faudrait-il alors libérer les peuples de leur ignorance quant à ce qu’ils prennent à tort pour la justice véritable ? Nullement. Du fait, de l’impossibilité d’établir un critère véritable et naturel du juste et de l’injuste, mieux vaut laisser le peuple s’imaginer que les lois auxquelles il obéit et qui garantissent la paix social sont justes, même s’il se trompe. Sans quoi, s’en est finit de tout ordre. De même convient-il d’enseigner au peuple que la soumission à l’autorité sert ses propres intérêts et non ceux de ses maîtres et qu’il serait dangereux de laisser au peuple la direction de ses propres affaires, cela du fait de l’inconstance qui encore une fois affecte la nature humaine (63).
Néanmoins demeure une limite à l’exercice de l’autorité. Il faut que celle-ci règne dans son ordre propre qui est celui de la force s’appliquant aux corps. Pascal distingue trois ordres, l’ordre de la chair, l’ordre de l’esprit et l’ordre du cœur. Le premier est celui de la force et de l’habitude, le second est celui de la science, le troisième celui de la foi. Chacun de ses ordres a son propre fondement qu’il convient de conserver à l’abri des autres. Aussi, le prince ne doit-il pas prétendre régner sur les esprits ou sur les cœurs en raison de la force qui est la sienne, pas plus que la science ne doit prétendre empiéter sur le domaine de la religion qui possède son ordre de révélation particulier, sans quoi s’ensuit la confusion et la disparition de l’ordre minimal qui subsiste encore dans la condition humaine. Le prince qui, au nom de la justice, prétendrait régenter les esprits et les cœurs ne serait qu’un tyran (54).
V. Raison des effets
Les deux liasses précédentes nous montraient les conséquences de la nature déchue de l’homme, son impuissance au bien, l’ignorance de sa nature véritable et la vanité de ses actions. Mais le thème de la justice, problématique en soi, puisque l’homme ne parvient pas à définir un ordre de justice véritable, nous a permis de voir comment de sa situation misérable l’homme tirait un ordre lui permettant néanmoins de vivre en paix.
Cette conséquence paradoxale (tirer un effet positif, l’ordre, d’un fondement négatif, l’ignorance du bien) indique une certaine rationalité à l’œuvre dans les effets négatifs introduits par le péché originel. Cette rationalité ne se découvre qu’a posteriori et ne saurait être immédiatement aperçu mais n’en est pas moins identifiable à celui qui sait observer la condition de l’homme déchu. C’est cette idée que Pascal entend signifier par la notion de « raison des effets ». En mathématique, « raison » désigne une loi qui gouverne une récurrence. Par exemple, dans la série « 1, 5, 9, 13,… », la raison qui gouverne la série est le nombre 4. Ainsi peut-on définir la raison comme une mesure réglant une suite en apparence dépourvue d’ordre. Appliqué à la morale, cette notion vient indiquer chez Pascal la règle qui se cache derrière une réalité en apparence absurde. L’effet est ce qui découle d’un principe premier, ici le péché originel. Trouver la règle qui, de la déraison et de la faiblesse humaine, permet de faire fonctionner l’ensemble humain, c’est cela que propose cette liasse, « de la raison des effets. »
La notion de justice, dont nous avons vu qu’elle ne permettait pas d’atteindre une définition naturelle et valable universellement, va se trouver ici particulièrement mise en lumière.
Dans l’état de corruption qui est le sien, l’homme est incapable d’obéir à une volonté droite et juste en elle-même. Seule la coutume règle pour chacun le cours quotidien de ses actions. Mais qu’est-ce qui rend la coutume contraignante et lui permet d’assurer le maintien d’un ordre cependant artificiel ? Le terme dont use Pascal est clair : il s’agit de la force. La force, qu’elle soit celle de l’autorité souveraine ou du nombre, met un terme aux dissensions possibles en contraignant chacun à suivre un même ordre de justice et rend possible l’imposition de règles universelles (76-78). L’ordre qui en découle n’est certes pas juste en soi, mais la justice ayant perdu toute force du fait de la nature perverse de l’homme, ce dernier se soumet à la force comme à la justice, et cela est déjà un moindre mal (79-90). En effet, le pire des maux serait la guerre civile. Or, en obéissant à la force parce qu’il croit qu’elle est juste, le peuple, quand bien même il s’abuse, se prémunit contre les conséquences fatales de la guerre. Peu importe pourquoi il obéit et à qui, cet ordre n’étant qu’un ordre humain sera toujours déraisonnable mais toutefois moins que la guerre elle-même (87-94). L’ordre ainsi produit est déraisonnable, voir grotesque (75-95) mais de cette faiblesse même se tire un remède à cette faiblesse (89).
Néanmoins, la force ne signifie pas pour autant la brutalité aveugle. La plupart du temps, les hommes se soumettent non à la force réelle (sans quoi il se soumettrait à la justice divine) mais à qui a l’apparence de la force. Ici de découvre le pouvoir quasiment magique de l’imagination qui permet à l’homme de s’attacher aux signes visibles comme à la présence de la chose réelle. Ceux qui ne possèdent pas la force des armes peuvent toujours compter sur l’effet que produit chez les hommes la représentation de leurs attributs imaginaires représentés par des signes visibles (80-82-88).
Celui qui découvre la « raison des effets » comprend à la foi l’absurdité et la vanité du monde et son efficacité. Ce dernier, conscient de l’ignorance naturelle dans laquelle l’homme est plongé, ne s’avisera pas de faire changer d’avis au plus grand nombre, sans quoi il ne gagnera que mépris de la part de ceux qui constituent la masse d’un troupeau ignorant des ressorts qui le font se mouvoir (77). Mieux vaut à cet habile homme qui a compris la folie du monde se tourner vers soi et ne pas chercher à faire montre de la conscience qu’il possède de l’ignorance naturelle à l’homme (81).
Ainsi l’habile, sans être hypocrite, vit avec ce que Pascal appelle une « pensée de derrière ». Il connaît l’ignorance du peuple mais la laisse produire ses effets raisonnables (85). Ainsi se soumet-il aux usages de la coutume non parce qu’il la pense juste en elle-même mais parce qu’il sait y discerner la condition de la paix sociale (83). Celui qui appelle à remettre en cause la coutume au nom d’un idéal de justice n’est qu’un demi-habile car il n’a pas compris que la justice est inaccessible à l’homme. Ainsi les opinions du peuple sont saines mais non pas au point où le pense le peuple (93). Aussi peut-on distinguer trois types de positions relativement à la conscience de la justesse des principes qui fondent la vie en commun :
- Le peuple qui se soumet aux signes d’une force imaginaire
- Les demi-habiles qui se rendant compte de l’erreur du peuple tentent de la rectifier
- Les habiles qui voyant dans l’illusion du peuple la condition de l’ordre la respecte en ne se vantant pas de savoir mais en se limitant à une ignorance savante (77)
L’appréhension du vrai et de la justesse des principes de justice est, dans une telle situation, fort complexe et finalement contradictoire. Nous sommes face à une réalité dialectique où une chose se découvre fausse en cela même qu’elle paraît vraie et inversement (86). L’homme est vain car ils s’attachent à des biens et des vérités qui n’en sont pas. Mais en même temps cette vanité est la condition de l’ordre commun. Néanmoins, l’homme demeure vain car il n’a pas conscience que la raison d’être de sa vaine conduite est autre que celle qu’il imagine.
Néanmoins, ne pouvant remédier à notre ignorance naturelle, mieux vaut laisser la croyance produire ses effets salutaires que de chercher à s’assurer de ce qui se refuse à la connaissance, c’est-à-dire le fondement dernier de la justice (91). La solution du sage sera de reconnaître son ignorance naturelle et s’en tenir à la croyance que la vérité nous est inaccessible. La justice ne dépend pas de notre raison, et pour cela vaut-il mieux la confier à la direction du cœur mais d’un cœur éclairé par la vérité de Dieu (92).
§78. Rechercher fin 12e provinciale.
Commentaire §77.
VI. Grandeur
Paradoxalement, et comme va le montrer cette liasse, c’est de sa misère que l’homme tire les moyens de s’élever, ce qui constitue justement sa grandeur (97). Par là il établit sa différence d’avec les animaux dépourvus de raison (96-98). Ce que fait l’homme, quoiqu’il en ignore le fondement et les conséquences, il le fait non par instinct mais par volonté et réflexion, même si ces facultés ont été corrompues par la Chute originel.
Pour expliquer la différence de l’homme et de l’animal, il convient de mettre en avant un principe spirituel présent chez le premier et absent chez le second qui pour cette raison s’apparente à une machine (Cf. Descartes, Lettre au marquis de Newcastle). Conformément à un postulat de la science de son temps qui veut qu’un effet soit proportionnel à sa cause, Pascal remarque implicitement que la matière ne saurait produire de mouvement spirituel (99). Dénier à l’homme la pensée, c’est lui faire quitter sa nature essentielle (102). Que cette pensée se loge dans tel ou tel partie du corps importe peu (102). Ce qu’il faut concevoir, c’est la différence essentielle qui s’ensuit de la présence en l’homme d’une faculté de penser qui lui permet de se définir autrement que par la seule impulsion naturelle, c’est là le signe de sa liberté (103).
Du point de vue corporel, rien ne nous distingue d’une portion quelconque de l’univers, si ce n’est notre situation infime. Jamais notre corps ne pourra couvrir l’univers, ne pourra atteindre sa limite. L’univers, par sa grandeur et ses distances, nous écrase. Et pourtant notre pensée peut englober l’univers et nous projeter bien au-delà des limites que nous assigne notre corps (104). Si donc l’homme possède une dignité, il ne la doit pas à sa conformation physique et corporelle, plus fragile qu’un roseau, mais de sa pensée qui lui permet d’appréhender l’infini (104).
Or cette appréhension raisonnée ne s’arrête pas à l’univers matériel mais permet à l’homme de se connaître lui-même et d’atteindre la conscience de sa propre condition morale (105). L’homme est misérable, c’est-à-dire dans un état de malheur du fait du péché qui lui a fait perdre sa félicité originelle. Mais il lui reste le souvenir de cette félicité première à laquelle il aspire, le plus souvent en errant, dans sa recherche d’un bonheur infini. Ne pouvant prétendre par lui-même atteindre cet état de perfection achevé, l’homme désespère de lui-même. Mais en cela il est conscient de sa condition présente. Et cette conscience l’élève au-dessus de tous les autres êtres de la nature qui ignorent leur condition et fait sa grandeur (105).
Encore une fois, la stratégie argumentative et apologétique de Pascal consiste à montrer le renversement d’une chose en son contraire. Le malheur qui afflige l’homme est le signe même de sa destination première au bonheur et l’indice d’une aspiration naturelle au bien et d’une condition supérieure à celle de l’animal (107). L’animal ne désespère pas de ce qu’il est car c’est là sa nature mais l’homme désespère justement de cette nature commune avec l’animal et par là témoigne que cette nature n’est pas celle qui lui est destinée. On ne se trouve pas malheureux de n’avoir qu’une bouche, car cela correspond à l’ordre naturel, mais l’on se trouve malheureux de n’avoir qu’un œil car cela n’est justement pas conforme à notre conformation naturelle. Cette analogie fait signe vers la condition présente de l’homme, celle d’une nature déchue de sa première et vraie nature (108).
Plus encore, et comme nous l’a montré l’analyse de la justice, l’homme parvient à tirer, de sa nature pécheresse, de sa concupiscence naturelle (étymologie : convoiter, désirer) et de son amour-propre, un ordre social qui le pousse à l’amour fraternel (109).
Doit-on pour autant vanter l’homme de sa perfection ? Nullement, puisque cette nature première nous est soustraite par le péché et la volonté défaillante. De sa félicité naturelle, l’homme n’a qu’un sentiment obscur et en aucune façon une connaissance claire et certaine. Allons plus loin, notre condition même nous empêche d’atteindre quelque certitude que ce soit dans l’ordre de la connaissance. Les premiers principes des choses nous sont cachés et le doute étreint celui qui réfléchit à la possibilité d’atteindre le vrai par la seule force de son esprit. D’où la légitime mise en cause de la connaissance par les sceptiques (100). Doit-on pour autant s’abandonner à la plus entière incertitude ?
Pour répondre à cette question, Pascal distingue deux ordres de connaissances, la connaissance de la raison et la connaissance du cœur ou l’opposition entre une connaissance discursive et une connaissance intuitive. La première ne nous permet que de conclure des raisonnements dont nous ne pouvons prouver les premiers principes. Ainsi nos raisonnements en géométrie ne parviendront jamais à démontrer la justesse de nos axiomes de départ (Cf. De l’esprit géométrique) mais uniquement à tirer les conclusions qui suivent de ces principes. Comment dès lors nous orienter dans la connaissance ? Il nous reste en fait un quelque chose de notre première condition et ce reste se montre à nous dans l’intuition que nous avons de certaines vérités premières et fondamentales mais inaccessibles à la raison. Nous ne pouvons pas douter qu’il existe un espace, un temps, un mouvement et pourtant nous ne pouvons le prouver par la raison. Ces premiers principes appartiennent à l’ordre de l’intuition et du sentiment. Nous le sentons par une évidence irrésistible.
Ainsi le cœur et la raison se complètent dans l’édification de la connaissance. Le cœur donne le sentiment des premiers principes, la raison déduit les conséquences qui en découlent. Mais chacun de ces ordres à son domaine propre qui ne doit pas être confondu. Le sentiment n’a pas à intervenir dans le cours des démonstrations, ni non plus la raison dans les choses de la foi. La raison est donc limitée mais notre connaissance ne l’est pas pour autant. Ce qui revient à dire que le savoir n’est pas tout entier d’ordre rationnel. Nous pouvons donc échapper au scepticisme qui n’atteint que la raison en nous confiant à l’ordre du cœur et de la foi. Néanmoins, les vérités accessibles par le cœur sont très restreintes. Notre nature corrompue doit se contenter la plupart du temps d’une raison faible et douteuse.
C’est ainsi que deux voies s’offrent à nous pour connaître Dieu, une inspiration venant du cœur et qui nous donne l’assurance d’une foi certaine. Mais cette inspiration ne concerne qu’un nombre restreint de bienheureux. Pour les autres demeurent la voie de la raison, toujours faible et incertaine, et à laquelle il sera souvent difficile de persuader des bienfaits de la Grâce (101).
Cf. De l’esprit géométrique
Commentaire : §101
VII. Contrariétés
Pascal nous montre donc combien il est difficile de saisir la vérité de l’homme. Cette vérité peut se résumer toute entière sous le terme de « contrariétés » qui fait le sujet de cette VIIe liasse. L’homme est un être double, marqué par une nature complexe et tiraillé entre deux natures contraires. L’homme est misérable, sa nature concupiscente le fait comparer aux animaux. Mais l’image qu’il porte de sa félicité première l’ouvre à une vérité supérieure et le rend comparable aux anges. L’homme, mi-ange, mi-bête, est à la fois misère et grandeur (112) et c’est dans cette contrariété que l’homme doit pénétrer la connaissance de sa condition présente.
Cette condition montre bien l’impuissance de la raison à rendre compte de l’homme. D’un point de vue logique, deux propositions contraires ne peuvent pas être vraies ensemble, elles sont incompatibles. Une chose ne peut pas être elle-même et son contraire, cela va à l’encontre du principe de contradiction. Et pourtant, ce qui est impossible d’un point de vue rationnel se révèle possible dans l’ordre existentiel et moral. L’homme est cette contrariété incarnée, mystère pour la raison qui se trouve impuissante à en saisir la nature véritable. « L’homme passe l’homme » repère Pascal à trois reprises (122) entendant par là que l’homme est un mystère à lui-même, que la connaissance de l’homme dépasse les capacités humaines et, par conséquent, qu’il faut aller chercher au-delà de l’homme ce qui peut rendre raison de sa nature impossible.
Les philosophes qui tentent d’exprimer la vérité sur l’homme peuvent se répartir en deux catégories (122) dont l’opposition illustre justement l’impossibilité pour la raison d’atteindre à la compréhension de l’homme. Ces deux principes opposés sont ceux du scepticisme et du dogmatisme : le premier doute entièrement de la possibilité pour la raison d’atteindre la vérité, le second croit, au contraire, que la raison est un guide suffisant pour accéder au vrai. Si l’on en croit les sceptiques aucun argument, ni aucun sentiment si profond soient-ils, ne peuvent nous persuader d’une vérité quelconque. Nous sommes victimes d’une illusion perpétuelle, si bien que nous ne pouvons même savoir avec certitude si nous veillons ou si nous dormons. Il n’est dès lors pas difficile au sceptique de mettre en cause les arguments du dogmatique. Sur quel fondement certain ce dernier pourra-t-il appuyer les évidences dont il se fait fort d’être détenteur ?
Et pourtant le sceptique se contredit lui-même, d’une part en ce qu’il ne peut pas ne pas suivre les injonctions de la nature qui le pousse à vivre et à combler ses besoins, d’autre part en ce qu’il se déclare détenir l’unique vérité au moment même où il nie la possibilité. Cette contradiction suffit à décourager le sceptique le plus téméraire mais ne nous rend toutefois pas certain des évidences du dogmatique confiant en la raison. Incapables de croire à la raison, mais impuissants à douter de tout, à quelle assurance pourrons-nous nous confier ? « Qui démêlera cet embrouillement ? »
Il ne reste, pour saisir ce qu’est l’homme, qu’à nous confier à une vérité qui nous dépasse et qui nous est révélée dans la foi au Christ, « vérité incréée et incarnée ». Mais quelle assurance peut-nous porter à chercher en Dieu la solution à ce mystère qu’est la condition humaine ?
C’est justement notre contradiction même qui doit nous y porter. En effet, si l’homme pouvait se suffire à lui-même, si sa nature était parfaite en elle-même, il n’aurait pas à douter d’atteindre et de posséder la vérité. Mais si l’homme n’était qu’un être d’erreur, perdu dans l’illusion et le mensonge, comment aurions-nous l’idée d’une vérité et d’un bonheur auxquels nous ne cessons d’aspirer sans néanmoins pouvoir l’atteindre ? La seule solution à ce problème consiste à supposer que nous avons reçu une nature parfaite et que cette nature nous a été ôtée. La clé de ce problème nous est livrée, non par la raison, mais par la foi et la révélation, celle de notre état d’innocence originel et du péché qui nous en a écarté.
Voilà de quoi décourager la raison. En effet, expliquer le mystère de la condition humaine par le mythe du péché originel, c’est-à-dire par un objet de foi, ne fait que redoubler le problème et nous laisse demeurer face à un mystère plus inconcevable encore. Comment raisonnablement accepter l’idée que l’acte d’un seul homme puisse enchaîner la suite des générations toute entière ? Cela n’est pas seulement absurde mais surtout parfaitement injuste aux yeux de notre raison. Cette idée a de quoi nous révolter ou nous effrayer mais elle est pourtant l’hypothèse nécessaire à laquelle nous devons recourir si nous voulons comprendre la contrariété de la nature humaine. Sans le recours au péché, nous ne pouvons comprendre que l’homme soit à la fois si misérable et si grand, incapable du bien et du bonheur et tourné vers ce bien et ce bonheur. Il ne reste dès lors qu’une option à la raison incapable de saisir la profondeur de ce mystère : se soumettre et attendre de la foi qu’elle comble l’ignorance que notre intelligence bornée est obligé d’avouer. De la foi révélée ainsi élevée au rang de connaissance ultime découle donc deux propositions contraires mais qui éclairent le mystère de l’homme : l’homme a été crée semblable à Dieu et s’est élevé au-dessus de toute créature ; l’homme a péché et dans son état de corruption est semblable aux bêtes (122). De ce fait, l’homme est aussi bien objet de louange que de dépréciation.
L’homme qui se connaît tel dans sa double nature doit s’aimer pour la tendance qui le porte au bien et se haïr du fait de la concupiscence qui le conduit, dans l’amour-propre et l’orgueil (111), à prolonger la faute originel (110). Ceux donc qui vantent la grandeur de l’homme ont raison, en partie, de même que ceux qui voit en lui un objet misérable, mais chacun a tort s’il ne considère qu’un des côtés de l’opposition, nourrissant ainsi la contradiction de la thèse adverse (113-118). L’homme n’est que ce tout agité de contradiction (114-115).
Du fait de cette double nature, il est vain de chercher des principes universels et naturels à la conduite humaine (116). Ayant perdu sa vraie nature, tout désormais peut lui être nature, pour peu qu’il y soit disposé par l’habitude, la coutume (116) ou l’orgueil (120). De là vient que les enfants même que l’on considère comme des êtres de nature sont en fait forgés par la coutume. S’il existait une nature propre de l’homme, celle-ci ne se perdrait point puisque la nature constitue l’essence d’un être. Si donc l’homme peut changer de nature sous l’effet des circonstances, c’est que cette dernière n’est pas naturelle (117). Ce que nous apprennent l’instinct, qui nous pousse à désirer le bonheur, et l’expérience, qui nous montre combien en suivant notre pente naturelle nous nous en éloignons toujours un peu plus, est seulement que nous avons perdu notre nature véritable (119). L’homme est une nature déchue.
L’habile qui sait cela, qui sait son ignorance du bien, ne peut, devant l’orgueil humain, qu’adopter une attitude de dérision, et, devant la plainte qu’élèvent ceux qui maudissent l’homme, en révéler la grandeur. L’homme est un monstre incompréhensible. Voilà tout ce que nous pouvons apprendre de lui, un monstre car composé de deux natures contraires et opposés, mais un monstre aussi en ce qu’il montre, fait signe, par sa misère même, vers son origine divine (121).
Commentaire §122.
VIII. Divertissement
Parvenus à ce point, reste à se demander comment l’homme assume cette contrariété de sa double nature. Comment l’homme peut-il supporter de vivre perpétuellement séparer du bien auquel il ne peut désormais plus prétendre par sa propre force ? Comment expliquer que le monde suive son cours alors que la condition de l’homme est celle d’un être déchu et misérable ? Comme va nous le montrer cette liasse, la réponse est déjà dans la question. C’est justement pour ne pas apercevoir sa misère que l’homme s’emploie à une multitude d’occupations qui lui permettent d’échapper à la considération de sa condition présente. Cette stratégie d’évitement à un nom : le divertissement (124).
La simple considération de l’homme montre qu’il n’est pas heureux. Qu’est-ce que le bonheur sinon un état de félicité parfait et continuel, absolu et indépendant des circonstances ? Or, l’homme cherche en permanence de nouveaux sujets d’occupation et de plaisirs, plaisirs qu’il ne dépend pas de lui de se donner et qui le soumettent aux caprices de la fortune. Que l’homme se rende ainsi dépendant de biens incertains pour faire ce qu’il croit être son bonheur témoigne justement du fait qu’il ne se satisfait pas de lui-même et n’est donc pas heureux (123).
Serait-il plus juste pour les hommes de savoir se satisfaire d’eux-mêmes et de ne pas courir ainsi les risques d’une contingence extérieure souvent fatale à leurs aspirations (126)? Or, c’est justement parce que se satisfaire lui-même est impossible à l’homme qu’il lui faut sans cesse chercher au dehors quelque occupation qui le détourne de la considération de soi. Du fait même de sa condition déchue, il ne saurait, en se contemplant lui-même, que désespérer de ne pas pouvoir se donner le bonheur qu’il cherche. A défaut donc de pouvoir se donner ce bonheur, il préfère se plonger dans les occupations qui lui évitent d’y penser. Les rois eux-mêmes, qui constituent pour la multitude le paradigme de l’homme satisfait, ont un besoin continuel de ces divertissements qui les empêchent de sombrer dans la contemplation d’eux-mêmes. Ces divertissements ne donnent pas en eux-mêmes accès au bonheur mais ils nous évitent de penser de l’impossibilité qui est la nôtre de prétendre au bien véritable. L’homme qui chasse ne place pas son bonheur dans la prise qu’il accomplit mais dans le temps passer à l’atteindre et qui, pour un temps, le détourne de l’ennui que représente la considération de lui-même. Instinctivement, l’homme sait que le bonheur s’apparente au repos et ne se trouve pas dans l’agitation, mais ce repos, l’absence d’occupations, conduit à la conscience malheureuse de notre nature, ce que Pascal nomme l’ennui. D’où s’ensuit une vaine poursuite qui ne nous rendra pas heureux mais nous préviendra de la conscience de notre malheur. « Un roi sans divertissement est un homme plein de misères » (127). Si l’homme peut supporter sa condition mortelle, c’est à la condition d’esquiver la conscience de cette condition, même quand on lui promettrait une mort douce (128).
La pensée de notre néant a donc de quoi nous désespérer et dès sa plus tendre enfance l’homme est éduqué en vue de n’y point songer. Pour ne pas voir son vide, il se résout à s’y enfoncer, démontrant par là même la vanité de l’existence à laquelle il se confie et dont il tente par tous les moyens de détourner sa conscience. « Le cœur de l’homme est creux et plein d’ordure ! » (129). Cette conclusion s’avère bien pessimiste si de la misère de cette vaine créature ne se tirait l’idée d’un « être nécessaire, éternel et infini » (125) dont la Grâce seule est à même de sauver l’homme de la souillure en laquelle il se complaît.
Cf. Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire.
Commentaire §126
Edition Michel le Guern
Vie de Pascal par Madame Périer, sa sœur
Naissance à Clermont le 19 juin 1623 d’Etienne Pascal, président à la Cour des aides et d’Antoinette Bergon.
Sa mère meurt en 1626. Pascal reçoit l’éducation directe de son père.
En 1632, installation à Paris.
Son père, refusant de lui enseigner les mathématiques avant qu’il ne connaisse le latin et le grec, Pascal découvre seul jusqu’à la 32ème proposition d’Euclide. Il rédige à 16 ans un Traité des coniques qui lui offre la reconnaissance des savants de son temps (Descartes, Gassendi, Fermat). Il invente à 19 ans sa machine d’arithmétique qu’il réalise en deux ans. Ses efforts continus entraînent une dégradation de sa santé.
A 23 ans, il réalise l’expérience du vide d’après Torricelli mais à 24 ans la découverte de Jésus-Christ le détourne de ces occupations savantes. C’est alors que sa sœur devient religieuse à Port-Royal des Champs. La santé de Pascal se dégradant, les médecins l’obligent à renoncer aux activités intellectuelles. C’est alors qu’il rentre dans le monde. Sur les conseils de sa sœur, Pascal renonce au monde âgé de 30 ans. Il se livre alors à une existence austère et dépouillée. Il vit ainsi cinq ans. Durant les quatre dernières années de sa vie, la maladie ne lui permet pas de travailler à son œuvre. Il meurt le 19 août 1662 à 39 ans.
Son œuvre apologétique est marquée par l’opposition aux jésuites qui substituaient la grâce suffisante (Dieu sauve ceux qui méritent de l’être) à la grâce efficace (l’homme est choisi et sauvé par Dieu sans pouvoir rien y faire).
II. Vanité
La liasse « Vanité » permet de découvrir une forme d’anthropologie pessimiste où paraissent les caractères principaux de la nature humaine (22):
- Inconstance : qui tire son origine du péché et implique que l’homme n’ait pas d’assise stable
- Ennui dont découle la vanité
- Inquiétude qui pousse au divertissement et aux satisfactions imaginaires
Ces différents caractères ont pour point commun la faiblesse d’une nature dont le péché originel fournit la clé de compréhension. Cette condition n’est pas le fruit du hasard mais tire son origine de la Chute d’Adam, de la volonté de l’homme de s’écarter du bien véritable, bien qu’il lui est impossible de recouvrir par ses propres forces sans le secours de la Grâce (12).
Parce qu’il a perdu sa véritable nature, juste, bonne et droite, l’homme erre entre deux infinis (38) entre lesquels il ne sait pas trouver de critères certains de la justice et du vrai (18-19-35-47). La conséquence de cette situation est la déraison du monde qui conduit les hommes à négliger la vie et le bien pour de fausses apparences (13-16-27-30). A défaut, d’un sens inné du juste et du bien et en raison de son aveuglement naturel, l’homme s’attache aux principes de l’amour-propre que sa vaine imagination et l’estime d’autrui lui représentent comme le bien absolu au détriment de la raison et du bien véritable (28-29-34). Finalement, le désordre et l’arbitraire mènent le monde (32). Tout le problème de cette réalité humaine inconstante est de ne pas pouvoir trouver d’assise sûre, sur laquelle appuyer son jugement. « Le monde est un branloir pérenne » disait Montaigne (Essais, III, 2), formule que Pascal reprend à son compte : « Tout branle avec le temps ».
Pour cette raison, l’homme fonde sa justice sur l’imagination (23-41). Ne pouvant donner un fondement certain et absolument juste aux principes qui régissent la vie sociale, l’homme s’en tient à des signes extérieurs qui valent comme l’indice d’une force inclinant au respect (17-26). Au final, la coutume finit par faire paraître juste ce qui n’est que l’effet d’une habitude (24). Aussi ne faut-il pas s’étonner de la relativité des critères du juste et de l’injuste, du légitime ou du vrai (18-46).
La conséquence de cette situation devrait conduire l’homme à désespérer. Mais pour ne justement pas apercevoir ce qu’il en est de sa nature déchue, l’homme se confie au divertissement comme un moyen d’échapper à l’insupportable vérité de son être (36-37). Les plus illustres d’entre les hommes n’en sont pas exempts (45). De là, l’homme s’ignore lui-même et se confie à l’imagination qui l’empêche de voir ce qu’il en est véritablement de lui-même (43). Cette agitation perpétuelle, ce renversement permanent d’une chose en son contraire (25) peut se nommer inquiétude, impossibilité pour l’homme de considérer son existence, considération qui le conduirait à désespérer de lui-même (ce que Pascal nommera l’ennui (33)) s’il ne s’attachait à de vains biens pour se distraire de cette sienne condition. Cette inquiétude, cette agitation frénétique, fait de l’histoire une suite de hasards et de déraison (42).
L’homme sage devrait reconnaître la vanité de l’homme et se tourner vers le désir du bien véritable (21). Au fond du désespoir entraîné par la considération de la vanité humaine, se trouve l’aspiration à la consolation. Pascal ne récuse pas tant l’existence d’un bien véritable que la possibilité pour l’homme de l’atteindre (19). Le doute qui saisit celui qui considère la réalité humaine et son inconstance est un moyen pour lui de s’apercevoir du manque qui affecte cette nature et du bien auquel l’homme devrait tendre, raison pour laquelle le sage se nourrit en quelques sortes de la folie des autres hommes (31). Reste alors pour tâche au sage de révéler son inconstance et sa déraison au monde, humilier la raison qui se croit triomphante (48) et que le bourdonnement d’une mouche suffit à détourner de son ouvrage en apparence si éclairé (44).
Cette nature humaine se résume donc toute entière sous les termes de vanité et d’imagination, vanité d’un jugement qui prétend tout jauger à l’aune de sa raison (11), mais dont une mouche suffit à révéler la fragilité (20).
Commentaire §41 :
III. Misère
IV. Ennui
La troisième et quatrième liasse « Misère » et « Ennui » poursuivent la description anthropologique entamée dans le livre précédent mais en nous permettant d’insister davantage encore sur les conséquences de la situation de l’homme à la suite du péché originel. Les maîtres mots sont ici inconstance, contradiction et impuissance de l’homme à trouver un critère vrai de la justice. Ces éléments déjà présents dans le livre précédent sont davantage appréciés dans leur rapport à la conscience que l’homme a de sa situation, conscience qui lui masque à lui-même la misère en laquelle le laisse demeurer la perte du bien véritable.
Toute la difficulté d’établir une véritable anthropologie de l’homme déchu consiste dans la contrariété qui affecte ce dernier et qui empêche d’en donner une description simple et univoque (51). On ne trouve pas d’accord de la nature humaine mais au contraire un désaccord permanent de cet être avec lui-même. Tout chez l’homme n’est que tendance vers (existence= ex-sistere), tendance vers un bien qu’il ignore, tendance vers une déchéance qu’il ne connaît pas comme telle. Le but de Pascal n’est dès lors pas la connaissance désintéressée de cet être, mais la prise de conscience des contradictions qui l’assaillent et qui donnent à connaître sa situation malheureuse. Cette anthropologie n’est donc pas séparable d’une évaluation morale qui constitue au final le seul intérêt véritable de cette connaissance de l’homme qui est tout aussi bien une connaissance de soi (68). Se connaître, c’est connaître notre misère et appeler à en être affranchi (65).
Mais qu’est-ce qui nous permet de tenir ce jugement négatif ? Quelle preuve a-t-on de ce malheur qui selon Pascal affecte la condition humaine ?
Un indice nous en est fourni par cette tendance inhérente à l’homme de s’oublier. Etymologiquement, divertir signifie détourner, comme détourner une somme d’argent. Se divertissant, l’homme se détourne de la considération de sa nature essentielle, ou plutôt se divertit pour n’avoir pas à reconnaître cette nature (66) et, se faisant enfreint, la justice, la justice de l’ordre universelle auquel son Créateur l’a voué dans l’état paradisiaque.
Ce divertissement marque la vanité de l’homme que la Bible, dans le livre de l’Ecclésiaste, répète inlassablement, « vanité des vanités, tout est vanité ». Là aussi l’étymologie nous renseigne : vanitas signifie le vide. L’homme est vide, c’est-à-dire radicalement et essentiellement marqué par le manque et par l’absence, absence du bien auquel sa nature première le destinait. Or cette absence crée en même temps la souffrance et le désir de combler ce vide, c’est-à-dire entretient le désir d’un bien, mais d’un bien qu’il ne peut plus se donner et auquel il substitue n’importe quel objet qui ne fera toujours qu’exhiber un peu plus l’impossibilité de combler ce vide. D’où une course effrénée de désir en désir qui, loin de lui permettre de combler ce manque, le détourne au moins de sa considération.
Dans l’état originel, l’homme voulait ce qu’il pouvait, son désir et sa puissance était en accord car conforme à l’ordre naturel prescrit par Dieu. Après la chute, l’homme n’est plus en mesure de pouvoir atteindre le bonheur dont il garde pourtant au fond de lui le souvenir. Sa volonté devenue impuissante car incapable du bien véritable ne lui permettra que de désirer le bien sans jamais pouvoir l’atteindre par lui-même (71). Ainsi l’homme est malheureux, tendant vers un bonheur duquel il ne peut se détourner mais qu’il ne peut se donner.
Mais ce dont l’homme souffre primitivement c’est de l’ignorance quant à sa véritable situation. Il sent qu’aucun bien ne le satisfait vraiment mais il ne peut s’empêcher d’imaginer que cette insatisfaction est causée par l’objet et non par sa volonté elle-même (69). La conséquence est alors l’incapacité de s’en tenir à une direction unique et à toujours entreprendre de chercher ailleurs le plaisir que l’objet présent ne peut donner. Ce qu’ignore alors l’homme c’est que le plaisir qu’il recherche se révèlera toujours aussi vide (vain) et entretiendra perpétuellement sa frustration et la contradiction entre les désirs qu’il cherche à assumer (56). De là résulte, l’inconstance, c’est-à-dire l’incapacité à tenir une voie droite.
Le seul guide que l’homme sait se donner est celui de l’amour-propre qui, au moment même, où se découvre la misère de sa situation le pousse à se flatter de sa sagesse (67) plutôt qu’à en tirer la conséquence nécessaire. Sans cette assise que constitue l’amour de lui-même, la croyance d’être tout, l’homme succomberait à l’angoisse infinie devant son propre néant (64), ce que Pascal nomme l’ennui. La prise de conscience de sa finitude conduit au vertige devant l’infini qui l’entoure. Perdu que nous sommes et rivés à notre amour-propre nous nous satisfaisons de ce que nous imaginons être une réalité. Dans le plus divers, l’imagination nous attache à une unité qui nous paraît constituer une base ferme bien qu’elle ne dissimule qu’une abstraction illusoire (61).
Résumons donc : l’homme est contradiction et inconstance, désir de l’infini et aspiration au néant. C’est toujours tendu entre deux opposés qu’évolue l’homme. Nous nous attachons à un bien qui provoque notre malheur (52), nous rions et pleurons tout ensemble et sur le même objet (50). Nous finissons même par ne plus reconnaître notre dignité propre, l’image que Dieu a empreinte en nous (49) et nous adorons des animaux comme dieux.
L’homme s’imagine maître de lui-même, indépendant, mais cette illusion lui masque sa condition véritable, la dépendance à l’égard d’une réalité étrangère et les besoins auxquels l’astreignent sa nature déchu (73). Reconnaître les nécessités, et donc les limitations auxquelles l’attachent son existence, lui permettrait déjà de se délivrer de l’illusion qu’il entretient à son égard (53). Malheureusement, c’est dès l’enfance que l’éducation conduit l’homme à s’attacher à une fausse idée de lui-même et à se complaire dans un amour-propre qui lui fait se croire tout lors qu’il n’est rien (59), mais un rien qui, s’il est pris en vue pour lui-même, ôte en même temps le désir d’agir.
Bref, nous agissons sans savoir et pour d’autres raisons que celles que nous croyons poursuivre, ces raisons se résumant dans l’amour-propre. En même temps, cet aiguillon illusoire est la condition de l’existence humaine qui pousse, dans l’agitation perpétuelle, à pousser toujours plus loin notre regard pour satisfaire notre orgueil (72) et échapper à l’ennui auquel nous voue la considération de la nullité du bien auquel nous nous attachons comme à une fin dernière (74).
Et pourtant c’est sur la base de cette confusion, sur le rien de son propre néant, que l’homme parvient à édifier un monde social dont l’unique fondement est l’imagination (60). La définition du mien et du tien, la justice qui découle de l’ignorance que l’homme entretient à l’égard de lui-même est double : d’une part, elle n’est pas la vraie justice, d’autre part, cette justice illusoire pallie à ses propres insuffisances, du fait de l’illusion que l’homme entretient à son propos, la croyant juste et bonne en soi. De l’illusion et de l’ignorance même de l’homme peuvent se tirer des fruits illusoires mais suffisants pour lui permettre d’entretenir et poursuivre sa vie.
Il y a un secret qui préside à l’instauration d’une justice commune qui suffit à l’homme alors même qu’elle n’est pas la vraie justice : c’est l’habitude de la regarder comme étant juste. C’est cette habitude que Pascal nomme coutume et qui, selon lui, fonde la possibilité d’un accord minimal permettant à chacun de poursuivre son désir vain sans dommage pour les autres (70). L’existence déchue de l’homme sécrète les solutions aux contradictions qu’elle tisse elle-même, ce qui en même temps redouble l’aveuglement de l’homme sur sa situation, situation qu’il pense fondée en raison (56). La justice à laquelle l’homme s’attache n’est que celle des mœurs auxquelles la coutume et l’habitude le rattachent depuis son enfance. Mais cette justice qui lui paraît naturelle est toute entière artificielle. La justice véritable, naturelle, est celle de l’ordre premier auquel Dieu confia Adam mais que ce dernier perdit du fait de sa volonté rebelle et qu’il nous est impossible dès lors d’atteindre sur la base de notre volonté corrompue, limitée et défaillante.
Aussi ne faut-il pas s’étonner que les principes d’une justice relative passent pour absolus aux yeux de ceux qui sont habitués à s’y conformer, ni non plus qu’une autre habitude, que d’autres mœurs engendre une conception toute différente de la justice (57). L’impossibilité de donner une définition définitive et absolue de la justice humaine expose l’homme aux hasards de la fortune (58) et d’un changement perpétuel des règles qui président à la vie en société (56). Finalement, cette justice humaine est tout sauf juste et repose sur l’arbitraire d’une volonté s’établissant en autorité régnante (55).
Faudrait-il alors libérer les peuples de leur ignorance quant à ce qu’ils prennent à tort pour la justice véritable ? Nullement. Du fait, de l’impossibilité d’établir un critère véritable et naturel du juste et de l’injuste, mieux vaut laisser le peuple s’imaginer que les lois auxquelles il obéit et qui garantissent la paix social sont justes, même s’il se trompe. Sans quoi, s’en est finit de tout ordre. De même convient-il d’enseigner au peuple que la soumission à l’autorité sert ses propres intérêts et non ceux de ses maîtres et qu’il serait dangereux de laisser au peuple la direction de ses propres affaires, cela du fait de l’inconstance qui encore une fois affecte la nature humaine (63).
Néanmoins demeure une limite à l’exercice de l’autorité. Il faut que celle-ci règne dans son ordre propre qui est celui de la force s’appliquant aux corps. Pascal distingue trois ordres, l’ordre de la chair, l’ordre de l’esprit et l’ordre du cœur. Le premier est celui de la force et de l’habitude, le second est celui de la science, le troisième celui de la foi. Chacun de ses ordres a son propre fondement qu’il convient de conserver à l’abri des autres. Aussi, le prince ne doit-il pas prétendre régner sur les esprits ou sur les cœurs en raison de la force qui est la sienne, pas plus que la science ne doit prétendre empiéter sur le domaine de la religion qui possède son ordre de révélation particulier, sans quoi s’ensuit la confusion et la disparition de l’ordre minimal qui subsiste encore dans la condition humaine. Le prince qui, au nom de la justice, prétendrait régenter les esprits et les cœurs ne serait qu’un tyran (54).
V. Raison des effets
Les deux liasses précédentes nous montraient les conséquences de la nature déchue de l’homme, son impuissance au bien, l’ignorance de sa nature véritable et la vanité de ses actions. Mais le thème de la justice, problématique en soi, puisque l’homme ne parvient pas à définir un ordre de justice véritable, nous a permis de voir comment de sa situation misérable l’homme tirait un ordre lui permettant néanmoins de vivre en paix.
Cette conséquence paradoxale (tirer un effet positif, l’ordre, d’un fondement négatif, l’ignorance du bien) indique une certaine rationalité à l’œuvre dans les effets négatifs introduits par le péché originel. Cette rationalité ne se découvre qu’a posteriori et ne saurait être immédiatement aperçu mais n’en est pas moins identifiable à celui qui sait observer la condition de l’homme déchu. C’est cette idée que Pascal entend signifier par la notion de « raison des effets ». En mathématique, « raison » désigne une loi qui gouverne une récurrence. Par exemple, dans la série « 1, 5, 9, 13,… », la raison qui gouverne la série est le nombre 4. Ainsi peut-on définir la raison comme une mesure réglant une suite en apparence dépourvue d’ordre. Appliqué à la morale, cette notion vient indiquer chez Pascal la règle qui se cache derrière une réalité en apparence absurde. L’effet est ce qui découle d’un principe premier, ici le péché originel. Trouver la règle qui, de la déraison et de la faiblesse humaine, permet de faire fonctionner l’ensemble humain, c’est cela que propose cette liasse, « de la raison des effets. »
La notion de justice, dont nous avons vu qu’elle ne permettait pas d’atteindre une définition naturelle et valable universellement, va se trouver ici particulièrement mise en lumière.
Dans l’état de corruption qui est le sien, l’homme est incapable d’obéir à une volonté droite et juste en elle-même. Seule la coutume règle pour chacun le cours quotidien de ses actions. Mais qu’est-ce qui rend la coutume contraignante et lui permet d’assurer le maintien d’un ordre cependant artificiel ? Le terme dont use Pascal est clair : il s’agit de la force. La force, qu’elle soit celle de l’autorité souveraine ou du nombre, met un terme aux dissensions possibles en contraignant chacun à suivre un même ordre de justice et rend possible l’imposition de règles universelles (76-78). L’ordre qui en découle n’est certes pas juste en soi, mais la justice ayant perdu toute force du fait de la nature perverse de l’homme, ce dernier se soumet à la force comme à la justice, et cela est déjà un moindre mal (79-90). En effet, le pire des maux serait la guerre civile. Or, en obéissant à la force parce qu’il croit qu’elle est juste, le peuple, quand bien même il s’abuse, se prémunit contre les conséquences fatales de la guerre. Peu importe pourquoi il obéit et à qui, cet ordre n’étant qu’un ordre humain sera toujours déraisonnable mais toutefois moins que la guerre elle-même (87-94). L’ordre ainsi produit est déraisonnable, voir grotesque (75-95) mais de cette faiblesse même se tire un remède à cette faiblesse (89).
Néanmoins, la force ne signifie pas pour autant la brutalité aveugle. La plupart du temps, les hommes se soumettent non à la force réelle (sans quoi il se soumettrait à la justice divine) mais à qui a l’apparence de la force. Ici de découvre le pouvoir quasiment magique de l’imagination qui permet à l’homme de s’attacher aux signes visibles comme à la présence de la chose réelle. Ceux qui ne possèdent pas la force des armes peuvent toujours compter sur l’effet que produit chez les hommes la représentation de leurs attributs imaginaires représentés par des signes visibles (80-82-88).
Celui qui découvre la « raison des effets » comprend à la foi l’absurdité et la vanité du monde et son efficacité. Ce dernier, conscient de l’ignorance naturelle dans laquelle l’homme est plongé, ne s’avisera pas de faire changer d’avis au plus grand nombre, sans quoi il ne gagnera que mépris de la part de ceux qui constituent la masse d’un troupeau ignorant des ressorts qui le font se mouvoir (77). Mieux vaut à cet habile homme qui a compris la folie du monde se tourner vers soi et ne pas chercher à faire montre de la conscience qu’il possède de l’ignorance naturelle à l’homme (81).
Ainsi l’habile, sans être hypocrite, vit avec ce que Pascal appelle une « pensée de derrière ». Il connaît l’ignorance du peuple mais la laisse produire ses effets raisonnables (85). Ainsi se soumet-il aux usages de la coutume non parce qu’il la pense juste en elle-même mais parce qu’il sait y discerner la condition de la paix sociale (83). Celui qui appelle à remettre en cause la coutume au nom d’un idéal de justice n’est qu’un demi-habile car il n’a pas compris que la justice est inaccessible à l’homme. Ainsi les opinions du peuple sont saines mais non pas au point où le pense le peuple (93). Aussi peut-on distinguer trois types de positions relativement à la conscience de la justesse des principes qui fondent la vie en commun :
- Le peuple qui se soumet aux signes d’une force imaginaire
- Les demi-habiles qui se rendant compte de l’erreur du peuple tentent de la rectifier
- Les habiles qui voyant dans l’illusion du peuple la condition de l’ordre la respecte en ne se vantant pas de savoir mais en se limitant à une ignorance savante (77)
L’appréhension du vrai et de la justesse des principes de justice est, dans une telle situation, fort complexe et finalement contradictoire. Nous sommes face à une réalité dialectique où une chose se découvre fausse en cela même qu’elle paraît vraie et inversement (86). L’homme est vain car ils s’attachent à des biens et des vérités qui n’en sont pas. Mais en même temps cette vanité est la condition de l’ordre commun. Néanmoins, l’homme demeure vain car il n’a pas conscience que la raison d’être de sa vaine conduite est autre que celle qu’il imagine.
Néanmoins, ne pouvant remédier à notre ignorance naturelle, mieux vaut laisser la croyance produire ses effets salutaires que de chercher à s’assurer de ce qui se refuse à la connaissance, c’est-à-dire le fondement dernier de la justice (91). La solution du sage sera de reconnaître son ignorance naturelle et s’en tenir à la croyance que la vérité nous est inaccessible. La justice ne dépend pas de notre raison, et pour cela vaut-il mieux la confier à la direction du cœur mais d’un cœur éclairé par la vérité de Dieu (92).
§78. Rechercher fin 12e provinciale.
Commentaire §77.
VI. Grandeur
Paradoxalement, et comme va le montrer cette liasse, c’est de sa misère que l’homme tire les moyens de s’élever, ce qui constitue justement sa grandeur (97). Par là il établit sa différence d’avec les animaux dépourvus de raison (96-98). Ce que fait l’homme, quoiqu’il en ignore le fondement et les conséquences, il le fait non par instinct mais par volonté et réflexion, même si ces facultés ont été corrompues par la Chute originel.
Pour expliquer la différence de l’homme et de l’animal, il convient de mettre en avant un principe spirituel présent chez le premier et absent chez le second qui pour cette raison s’apparente à une machine (Cf. Descartes, Lettre au marquis de Newcastle). Conformément à un postulat de la science de son temps qui veut qu’un effet soit proportionnel à sa cause, Pascal remarque implicitement que la matière ne saurait produire de mouvement spirituel (99). Dénier à l’homme la pensée, c’est lui faire quitter sa nature essentielle (102). Que cette pensée se loge dans tel ou tel partie du corps importe peu (102). Ce qu’il faut concevoir, c’est la différence essentielle qui s’ensuit de la présence en l’homme d’une faculté de penser qui lui permet de se définir autrement que par la seule impulsion naturelle, c’est là le signe de sa liberté (103).
Du point de vue corporel, rien ne nous distingue d’une portion quelconque de l’univers, si ce n’est notre situation infime. Jamais notre corps ne pourra couvrir l’univers, ne pourra atteindre sa limite. L’univers, par sa grandeur et ses distances, nous écrase. Et pourtant notre pensée peut englober l’univers et nous projeter bien au-delà des limites que nous assigne notre corps (104). Si donc l’homme possède une dignité, il ne la doit pas à sa conformation physique et corporelle, plus fragile qu’un roseau, mais de sa pensée qui lui permet d’appréhender l’infini (104).
Or cette appréhension raisonnée ne s’arrête pas à l’univers matériel mais permet à l’homme de se connaître lui-même et d’atteindre la conscience de sa propre condition morale (105). L’homme est misérable, c’est-à-dire dans un état de malheur du fait du péché qui lui a fait perdre sa félicité originelle. Mais il lui reste le souvenir de cette félicité première à laquelle il aspire, le plus souvent en errant, dans sa recherche d’un bonheur infini. Ne pouvant prétendre par lui-même atteindre cet état de perfection achevé, l’homme désespère de lui-même. Mais en cela il est conscient de sa condition présente. Et cette conscience l’élève au-dessus de tous les autres êtres de la nature qui ignorent leur condition et fait sa grandeur (105).
Encore une fois, la stratégie argumentative et apologétique de Pascal consiste à montrer le renversement d’une chose en son contraire. Le malheur qui afflige l’homme est le signe même de sa destination première au bonheur et l’indice d’une aspiration naturelle au bien et d’une condition supérieure à celle de l’animal (107). L’animal ne désespère pas de ce qu’il est car c’est là sa nature mais l’homme désespère justement de cette nature commune avec l’animal et par là témoigne que cette nature n’est pas celle qui lui est destinée. On ne se trouve pas malheureux de n’avoir qu’une bouche, car cela correspond à l’ordre naturel, mais l’on se trouve malheureux de n’avoir qu’un œil car cela n’est justement pas conforme à notre conformation naturelle. Cette analogie fait signe vers la condition présente de l’homme, celle d’une nature déchue de sa première et vraie nature (108).
Plus encore, et comme nous l’a montré l’analyse de la justice, l’homme parvient à tirer, de sa nature pécheresse, de sa concupiscence naturelle (étymologie : convoiter, désirer) et de son amour-propre, un ordre social qui le pousse à l’amour fraternel (109).
Doit-on pour autant vanter l’homme de sa perfection ? Nullement, puisque cette nature première nous est soustraite par le péché et la volonté défaillante. De sa félicité naturelle, l’homme n’a qu’un sentiment obscur et en aucune façon une connaissance claire et certaine. Allons plus loin, notre condition même nous empêche d’atteindre quelque certitude que ce soit dans l’ordre de la connaissance. Les premiers principes des choses nous sont cachés et le doute étreint celui qui réfléchit à la possibilité d’atteindre le vrai par la seule force de son esprit. D’où la légitime mise en cause de la connaissance par les sceptiques (100). Doit-on pour autant s’abandonner à la plus entière incertitude ?
Pour répondre à cette question, Pascal distingue deux ordres de connaissances, la connaissance de la raison et la connaissance du cœur ou l’opposition entre une connaissance discursive et une connaissance intuitive. La première ne nous permet que de conclure des raisonnements dont nous ne pouvons prouver les premiers principes. Ainsi nos raisonnements en géométrie ne parviendront jamais à démontrer la justesse de nos axiomes de départ (Cf. De l’esprit géométrique) mais uniquement à tirer les conclusions qui suivent de ces principes. Comment dès lors nous orienter dans la connaissance ? Il nous reste en fait un quelque chose de notre première condition et ce reste se montre à nous dans l’intuition que nous avons de certaines vérités premières et fondamentales mais inaccessibles à la raison. Nous ne pouvons pas douter qu’il existe un espace, un temps, un mouvement et pourtant nous ne pouvons le prouver par la raison. Ces premiers principes appartiennent à l’ordre de l’intuition et du sentiment. Nous le sentons par une évidence irrésistible.
Ainsi le cœur et la raison se complètent dans l’édification de la connaissance. Le cœur donne le sentiment des premiers principes, la raison déduit les conséquences qui en découlent. Mais chacun de ces ordres à son domaine propre qui ne doit pas être confondu. Le sentiment n’a pas à intervenir dans le cours des démonstrations, ni non plus la raison dans les choses de la foi. La raison est donc limitée mais notre connaissance ne l’est pas pour autant. Ce qui revient à dire que le savoir n’est pas tout entier d’ordre rationnel. Nous pouvons donc échapper au scepticisme qui n’atteint que la raison en nous confiant à l’ordre du cœur et de la foi. Néanmoins, les vérités accessibles par le cœur sont très restreintes. Notre nature corrompue doit se contenter la plupart du temps d’une raison faible et douteuse.
C’est ainsi que deux voies s’offrent à nous pour connaître Dieu, une inspiration venant du cœur et qui nous donne l’assurance d’une foi certaine. Mais cette inspiration ne concerne qu’un nombre restreint de bienheureux. Pour les autres demeurent la voie de la raison, toujours faible et incertaine, et à laquelle il sera souvent difficile de persuader des bienfaits de la Grâce (101).
Cf. De l’esprit géométrique
Commentaire : §101
VII. Contrariétés
Pascal nous montre donc combien il est difficile de saisir la vérité de l’homme. Cette vérité peut se résumer toute entière sous le terme de « contrariétés » qui fait le sujet de cette VIIe liasse. L’homme est un être double, marqué par une nature complexe et tiraillé entre deux natures contraires. L’homme est misérable, sa nature concupiscente le fait comparer aux animaux. Mais l’image qu’il porte de sa félicité première l’ouvre à une vérité supérieure et le rend comparable aux anges. L’homme, mi-ange, mi-bête, est à la fois misère et grandeur (112) et c’est dans cette contrariété que l’homme doit pénétrer la connaissance de sa condition présente.
Cette condition montre bien l’impuissance de la raison à rendre compte de l’homme. D’un point de vue logique, deux propositions contraires ne peuvent pas être vraies ensemble, elles sont incompatibles. Une chose ne peut pas être elle-même et son contraire, cela va à l’encontre du principe de contradiction. Et pourtant, ce qui est impossible d’un point de vue rationnel se révèle possible dans l’ordre existentiel et moral. L’homme est cette contrariété incarnée, mystère pour la raison qui se trouve impuissante à en saisir la nature véritable. « L’homme passe l’homme » repère Pascal à trois reprises (122) entendant par là que l’homme est un mystère à lui-même, que la connaissance de l’homme dépasse les capacités humaines et, par conséquent, qu’il faut aller chercher au-delà de l’homme ce qui peut rendre raison de sa nature impossible.
Les philosophes qui tentent d’exprimer la vérité sur l’homme peuvent se répartir en deux catégories (122) dont l’opposition illustre justement l’impossibilité pour la raison d’atteindre à la compréhension de l’homme. Ces deux principes opposés sont ceux du scepticisme et du dogmatisme : le premier doute entièrement de la possibilité pour la raison d’atteindre la vérité, le second croit, au contraire, que la raison est un guide suffisant pour accéder au vrai. Si l’on en croit les sceptiques aucun argument, ni aucun sentiment si profond soient-ils, ne peuvent nous persuader d’une vérité quelconque. Nous sommes victimes d’une illusion perpétuelle, si bien que nous ne pouvons même savoir avec certitude si nous veillons ou si nous dormons. Il n’est dès lors pas difficile au sceptique de mettre en cause les arguments du dogmatique. Sur quel fondement certain ce dernier pourra-t-il appuyer les évidences dont il se fait fort d’être détenteur ?
Et pourtant le sceptique se contredit lui-même, d’une part en ce qu’il ne peut pas ne pas suivre les injonctions de la nature qui le pousse à vivre et à combler ses besoins, d’autre part en ce qu’il se déclare détenir l’unique vérité au moment même où il nie la possibilité. Cette contradiction suffit à décourager le sceptique le plus téméraire mais ne nous rend toutefois pas certain des évidences du dogmatique confiant en la raison. Incapables de croire à la raison, mais impuissants à douter de tout, à quelle assurance pourrons-nous nous confier ? « Qui démêlera cet embrouillement ? »
Il ne reste, pour saisir ce qu’est l’homme, qu’à nous confier à une vérité qui nous dépasse et qui nous est révélée dans la foi au Christ, « vérité incréée et incarnée ». Mais quelle assurance peut-nous porter à chercher en Dieu la solution à ce mystère qu’est la condition humaine ?
C’est justement notre contradiction même qui doit nous y porter. En effet, si l’homme pouvait se suffire à lui-même, si sa nature était parfaite en elle-même, il n’aurait pas à douter d’atteindre et de posséder la vérité. Mais si l’homme n’était qu’un être d’erreur, perdu dans l’illusion et le mensonge, comment aurions-nous l’idée d’une vérité et d’un bonheur auxquels nous ne cessons d’aspirer sans néanmoins pouvoir l’atteindre ? La seule solution à ce problème consiste à supposer que nous avons reçu une nature parfaite et que cette nature nous a été ôtée. La clé de ce problème nous est livrée, non par la raison, mais par la foi et la révélation, celle de notre état d’innocence originel et du péché qui nous en a écarté.
Voilà de quoi décourager la raison. En effet, expliquer le mystère de la condition humaine par le mythe du péché originel, c’est-à-dire par un objet de foi, ne fait que redoubler le problème et nous laisse demeurer face à un mystère plus inconcevable encore. Comment raisonnablement accepter l’idée que l’acte d’un seul homme puisse enchaîner la suite des générations toute entière ? Cela n’est pas seulement absurde mais surtout parfaitement injuste aux yeux de notre raison. Cette idée a de quoi nous révolter ou nous effrayer mais elle est pourtant l’hypothèse nécessaire à laquelle nous devons recourir si nous voulons comprendre la contrariété de la nature humaine. Sans le recours au péché, nous ne pouvons comprendre que l’homme soit à la fois si misérable et si grand, incapable du bien et du bonheur et tourné vers ce bien et ce bonheur. Il ne reste dès lors qu’une option à la raison incapable de saisir la profondeur de ce mystère : se soumettre et attendre de la foi qu’elle comble l’ignorance que notre intelligence bornée est obligé d’avouer. De la foi révélée ainsi élevée au rang de connaissance ultime découle donc deux propositions contraires mais qui éclairent le mystère de l’homme : l’homme a été crée semblable à Dieu et s’est élevé au-dessus de toute créature ; l’homme a péché et dans son état de corruption est semblable aux bêtes (122). De ce fait, l’homme est aussi bien objet de louange que de dépréciation.
L’homme qui se connaît tel dans sa double nature doit s’aimer pour la tendance qui le porte au bien et se haïr du fait de la concupiscence qui le conduit, dans l’amour-propre et l’orgueil (111), à prolonger la faute originel (110). Ceux donc qui vantent la grandeur de l’homme ont raison, en partie, de même que ceux qui voit en lui un objet misérable, mais chacun a tort s’il ne considère qu’un des côtés de l’opposition, nourrissant ainsi la contradiction de la thèse adverse (113-118). L’homme n’est que ce tout agité de contradiction (114-115).
Du fait de cette double nature, il est vain de chercher des principes universels et naturels à la conduite humaine (116). Ayant perdu sa vraie nature, tout désormais peut lui être nature, pour peu qu’il y soit disposé par l’habitude, la coutume (116) ou l’orgueil (120). De là vient que les enfants même que l’on considère comme des êtres de nature sont en fait forgés par la coutume. S’il existait une nature propre de l’homme, celle-ci ne se perdrait point puisque la nature constitue l’essence d’un être. Si donc l’homme peut changer de nature sous l’effet des circonstances, c’est que cette dernière n’est pas naturelle (117). Ce que nous apprennent l’instinct, qui nous pousse à désirer le bonheur, et l’expérience, qui nous montre combien en suivant notre pente naturelle nous nous en éloignons toujours un peu plus, est seulement que nous avons perdu notre nature véritable (119). L’homme est une nature déchue.
L’habile qui sait cela, qui sait son ignorance du bien, ne peut, devant l’orgueil humain, qu’adopter une attitude de dérision, et, devant la plainte qu’élèvent ceux qui maudissent l’homme, en révéler la grandeur. L’homme est un monstre incompréhensible. Voilà tout ce que nous pouvons apprendre de lui, un monstre car composé de deux natures contraires et opposés, mais un monstre aussi en ce qu’il montre, fait signe, par sa misère même, vers son origine divine (121).
Commentaire §122.
VIII. Divertissement
Parvenus à ce point, reste à se demander comment l’homme assume cette contrariété de sa double nature. Comment l’homme peut-il supporter de vivre perpétuellement séparer du bien auquel il ne peut désormais plus prétendre par sa propre force ? Comment expliquer que le monde suive son cours alors que la condition de l’homme est celle d’un être déchu et misérable ? Comme va nous le montrer cette liasse, la réponse est déjà dans la question. C’est justement pour ne pas apercevoir sa misère que l’homme s’emploie à une multitude d’occupations qui lui permettent d’échapper à la considération de sa condition présente. Cette stratégie d’évitement à un nom : le divertissement (124).
La simple considération de l’homme montre qu’il n’est pas heureux. Qu’est-ce que le bonheur sinon un état de félicité parfait et continuel, absolu et indépendant des circonstances ? Or, l’homme cherche en permanence de nouveaux sujets d’occupation et de plaisirs, plaisirs qu’il ne dépend pas de lui de se donner et qui le soumettent aux caprices de la fortune. Que l’homme se rende ainsi dépendant de biens incertains pour faire ce qu’il croit être son bonheur témoigne justement du fait qu’il ne se satisfait pas de lui-même et n’est donc pas heureux (123).
Serait-il plus juste pour les hommes de savoir se satisfaire d’eux-mêmes et de ne pas courir ainsi les risques d’une contingence extérieure souvent fatale à leurs aspirations (126)? Or, c’est justement parce que se satisfaire lui-même est impossible à l’homme qu’il lui faut sans cesse chercher au dehors quelque occupation qui le détourne de la considération de soi. Du fait même de sa condition déchue, il ne saurait, en se contemplant lui-même, que désespérer de ne pas pouvoir se donner le bonheur qu’il cherche. A défaut donc de pouvoir se donner ce bonheur, il préfère se plonger dans les occupations qui lui évitent d’y penser. Les rois eux-mêmes, qui constituent pour la multitude le paradigme de l’homme satisfait, ont un besoin continuel de ces divertissements qui les empêchent de sombrer dans la contemplation d’eux-mêmes. Ces divertissements ne donnent pas en eux-mêmes accès au bonheur mais ils nous évitent de penser de l’impossibilité qui est la nôtre de prétendre au bien véritable. L’homme qui chasse ne place pas son bonheur dans la prise qu’il accomplit mais dans le temps passer à l’atteindre et qui, pour un temps, le détourne de l’ennui que représente la considération de lui-même. Instinctivement, l’homme sait que le bonheur s’apparente au repos et ne se trouve pas dans l’agitation, mais ce repos, l’absence d’occupations, conduit à la conscience malheureuse de notre nature, ce que Pascal nomme l’ennui. D’où s’ensuit une vaine poursuite qui ne nous rendra pas heureux mais nous préviendra de la conscience de notre malheur. « Un roi sans divertissement est un homme plein de misères » (127). Si l’homme peut supporter sa condition mortelle, c’est à la condition d’esquiver la conscience de cette condition, même quand on lui promettrait une mort douce (128).
La pensée de notre néant a donc de quoi nous désespérer et dès sa plus tendre enfance l’homme est éduqué en vue de n’y point songer. Pour ne pas voir son vide, il se résout à s’y enfoncer, démontrant par là même la vanité de l’existence à laquelle il se confie et dont il tente par tous les moyens de détourner sa conscience. « Le cœur de l’homme est creux et plein d’ordure ! » (129). Cette conclusion s’avère bien pessimiste si de la misère de cette vaine créature ne se tirait l’idée d’un « être nécessaire, éternel et infini » (125) dont la Grâce seule est à même de sauver l’homme de la souillure en laquelle il se complaît.
Cf. Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire.
Commentaire §126
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
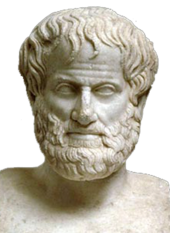
 Accueil
Accueil
